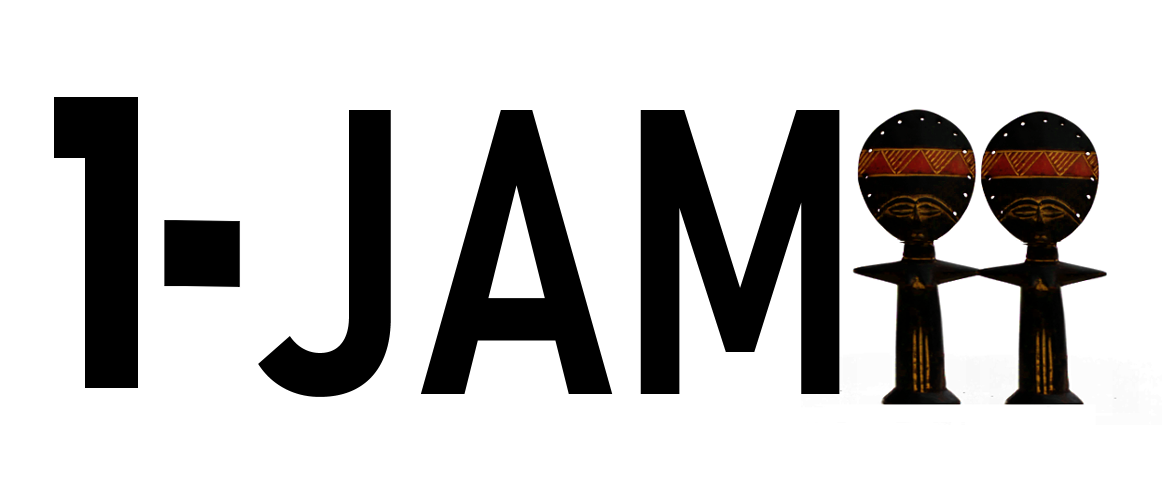Après Kemi Seba, le cas Yamb Nathalie ravive au Burundi la mémoire des luttes contre la colonisation et la politique néocoloniale européenne.
Gitega, 11/08/2025 (BdiAgnews) – Une sanction qui rouvre des plaies mal cicatrisées. Le 27 juin 2025, le Conseil de l’Union européenne a pris pour cible une figure contemporaine du panafricanisme : Yamb Nathalie, surnommée « La Dame de Sotchi » depuis son intervention marquante au sommet Russie-Afrique de 2019. Officiellement, cette mesure ne viserait pas ses idées, mais s’inscrirait dans le cadre de la « sécurité », sous couvert de « menaces hybrides ». En coulisses, cependant, nombreux sont ceux qui y reconnaissent l’écho d’une vieille rengaine : l’instrumentalisation du pouvoir européen pour punir quiconque ose défier l’ordre colonial persistante. La militante se voit désormais interdire l’accès à l’Europe et ses avoirs y sont gelés. Tout cela résonne douloureusement dans l’histoire récente et ancienne du Burundi, pays qui fait encore aujourd’hui face à « la Croix et à la Bannière » [1].
Le Burundi connaît trop bien ce langage. En 2015 déjà, Bruxelles frappait Bujumbura de sanctions, gelant des coopérations et limitant les échanges diplomatiques sous le fallacieux prétexte de « préoccupations sécuritaires ». En réalité, il s’agissait d’un avertissement adressé à un pays des Grands Lacs refusant de se plier aux injonctions européennes. Une manière à peine voilée de rappeler qui prétend encore dicter sa loi.
Pour l’UE, Yamb Nathalie incarnerait un « relais d’influence stratégique » de Moscou, entre liens supposés avec Wagner et rôle présumé dans une propagande hostile. Pour ses partisans, elle est avant tout une voix puissante, exhortant les Africains à briser les chaînes invisibles de la domination postcoloniale. Le paradoxe est saisissant : le 16 février 2025, l’Union africaine reconnaissait la colonisation, l’esclavage et la traite transatlantique comme crimes contre l’humanité (décision Assembly/AU/Dec.934(XXXVIII)). Comment, dès lors, justifier la sanction d’une militante dont le combat s’inscrit précisément dans cette lignée ?
Sous la présidence de Ndikuriyo Réverien, le Sénat du Burundi avait réclamé à l’Allemagne et à la Belgique des réparations financières pour les crimes et pillages coloniaux. Un geste rare, assumé, qui avait réinstallé la question des réparations et de la mémoire au cœur des débats politiques africains.
L’affaire Yamb Nathalie transcende l’individu. Elle pose une question essentielle : un Africain a-t-il encore le droit de dénoncer l’héritage colonial sans redouter les représailles diplomatiques ? Pour le Burundi, la réponse est sans équivoque : oui. Et c’est pourquoi Gitega, s’il le juge nécessaire, peut passer à l’action en : Offrant à Yamb Nathalie une tribune et une protection juridique ; Portant l’affaire devant la Commission et le Conseil de paix et de sécurité de l’UA ; Saisissant le prochain sommet UA-UE pour exiger des comptes et la levée des sanctions.
Les médias burundais, publics comme privés, peuvent s’emparer de ce dossier pour rappeler la décision historique de l’UA de février 2025 et éclairer les enjeux mémoriels et souverainistes. Des conférences à Gitega, des reportages sur la RTNB, et la mobilisation de juristes et d’historiens pourraient faire du cas Yamb un catalyseur, propulsant dans l’arène africaine le débat sur la colonialité toujours à l’œuvre dans les relations UE-Afrique.
Pour le Burundi, Ingoma y’Uburundi [2], et sa Diaspora[3], combattre la colonialité n’est pas un crime. Défendre les intérêts de l’Afrique est un devoir.
Références :
[1] Baranyanka Charles, Le Burundi face à la Croix et à la Bannière, Bruxelles, 2015. (La « Croix et la Bannière » désigne l’alliance historique entre le Vatican, la France – notamment via les Pères Blancs de Lavigerie –, l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique et les États-Unis contre l’ordre traditionnel burundais depuis le XIXᵉ siècle.)
[2] Nahimana Karolero Pascal, Histoire du Burundi : Les grandes dates de l’histoire des Barundi et de l’État millénaire africain – Ingoma y’Uburundi, Bruxelles, Génération Afrique, 2024.
[3] Nahimana Karolero Pascal. Burundi : La diaspora burundaise : Du Monde, de Belgique et d’ailleurs – Histoire, trajectoires et ancrage. Bruxelles : Génération Afrique, 2025.



Sources : Nahimana P., http://burundi-agnews.org, Lundi 11 août 2025